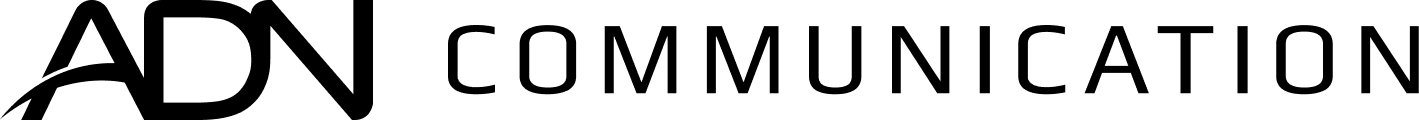HISTOIRE
C'est à partir des années 1865-70 que des colons et leur famille quittent leur terre des alentours de Yamachiche, St-Barnabé et autres endroits pour venir s'installer le long de la rivière Petite Shawinigan attirés par les activités forestières autour des lacs d'en haut.
Deux agglomérations se constituèrent, l'une où se situe aujourd'hui le pont couvert, du coté de l'actuel chemin St-François. L'autre groupe choisit de s'installer près du petit lac des Souris, aujourd'hui lac Bellemare. Nos ancêtres étaient croyants et pratiquants, il était donc dans l'ordre des choses de présenter une pétition sans tarder à l'évêché (Trois-Rivières) pour obtenir la mise en marche du processus de création d'une paroisse et les services d'un prêtre. Il était bien reconnu que là où s'érigerait une première petite chapelle deviendrait le choix du site de la future église et du centre villageois. En 1871, les prêtres enquêteurs de l'évêché décident que la chapelle serait construite dans le chemin St-François ce qui confirme la victoire de l'agglomération du site du pont couvert. Ce sera d'abord une desserte appelée Mission St-Matthieu-de-Caxton. Le missionnaire sera le curé de St-Boniface. L'érection en paroisse se fera en 1874 suivie de l'érection civile en 1876.
Il faudra cependant attendre 1886 avant que la décision soit rendue sur le choix du site de l'église. Coup de théâtre! L'évêque choisit le site du lac Bellemare ne pouvant résister au puissant Raphaël Duchaine qui offrit en don de vastes terrains en échange de cette décision de l'évêque.
Le 1er janvier 1887 on proclame la Municipalité de paroisse de St-Matthieu du lac Bellemare conformément aux lettres patentes de Québec. En octobre de la même année, on bénira la nouvelle chapelle. Le tiraillement durera jusqu'en 1912 pour tenter de ramener l'emplacement de l'église au site du pont couvert. La première église sera finalement construite en 1913 sur le site de l'église actuelle.
L'histoire de la colonisation du Québec compte plusieurs exemples de foudroyants affrontements autour du choix de l'implantation de l'église. Il en va de même de l'orthographe actuel qui a fait perdre un ''t'' à l'Évangéliste Matthieu qui a donné son nom à la municipalité
Le développement du réseau routier dont la route 351 et le chemin St-François fait vite de la Municipalité une zone privilégiée de villégiature. L'implantation du Parc national de la Mauricie au début des années 70 viendra confirmer sa vocation récréotouristique et entraînera, en 1998, l'adoption de son nom actuel;
Saint-Mathieu-du-Parc.
|
Incendie septembre 1948 |
Dates importantes
- 1874 (10 juillet) : érection canonique.
- 1876 (17 juillet) : érection civile.
- 1887 (1er janvier) : proclamation de Saint-Mathieu-du-Lac-Bellemare en Municipalité de paroisse.
- 1913 : construction de l'église à l'emplacement actuel.
- 1917 : incendie de l'école du village.
- 1918 : ravages de la grippe espagnole.
- 1919 : feu de forêt qui ceinture le village mais celui-ci s'en sort indemne.
- 1936 : construction du pont couvert.
- 1937 : venue des sœurs enseignantes filles de Jésus dans la paroisse.
- 1948 (25 septembre) : le feu détruit l'église et la moitié du village : quatre magasins et vingt et une familles sont sans foyer.
- 1970 : création du Parc national de la Mauricie.
- 1998 (11 mars) : changement de nom de la paroisse de Saint-Mathieu pour lui donner le nom de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc.
- 2015 : révision complète de la nomenclature des noms de rue.
GÉOGRAPHIE
Saint-Mathieu-du-Parc est sise au gré du relief vallonné des Laurentides. L'environnement est représentatif de la région précambrienne des Grands Lacs et du Saint-Laurent. La région abrite une faune variée et abondante. Elle regorge de lacs, de ruisseaux, de chutes et de cascades. Saint-Mathieu-du-Parc est située à la limite méridionale du Bouclier canadien, non loin de la ligne de rencontre avec les basses terres du Saint-Laurent. La chaîne des Laurentides, vieille de plus de 955 millions d'années, aurait jadis atteint la hauteur de l'Himalaya. Au cours des centaines de millions d'années, ces montagnes ont été érodées jusqu'à leur racine.
Durant le dernier million d'années, le paysage a été remodelé par le passage de plusieurs glaciers continentaux qui ont recouvert l'Amérique du Nord jusqu'à la latitude de l'état de New York. Ces gigantesques glaciers, épais d'un à deux kilomètres ont aplani le relief, approfondi les vallées et même affaissé la croûte terrestre. Le dernier glacier a entamé son recul vers le nord, il y a environ dix mille ans. En fondant, il a abandonné derrière lui des volumes incroyables de débris rocheux et sablonneux, il a créé une multitude de lacs et libéré une quantité phénoménale d'eau. La pédologie de la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc témoigne de la présence de ces glaciers dans la région il y a des milliers d'années lorsque tout le territoire était recouvert par une épaisse couche de glace. En effet, on retrouve un phénomène rare présent dans quelques régions du Québec que l'on appelle esker. Cette formation glaciaire se présente généralement sous forme de buttes allongées s'étendant sur plusieurs mètres de longueur voire même sur des kilomètres comme dans le cas de Saint-Mathieu-du-Parc. L'esker est long de 7,5 kilomètres et d'une largeur moyenne de 76 mètres. Son tracé débute sur la rive nord du lac Goulet pour ensuite passer sous le lac. Il est également à l'origine de la présence de l'île au lac Brûlé. Il longe le chemin Saint-Édouard jusqu'au lac Trudel vers le centre du village, séparant, au passage, le lac Bellemare en deux, créant deux presqu'îles qui entrent à l'intérieur du lac. Il continue son parcours jusqu'au lac Vert pour finalement s'arrêter aux lacs Gareau. La route 351 passe d'ailleurs sur l'esker, entre le petit et le grand lac Gareau.